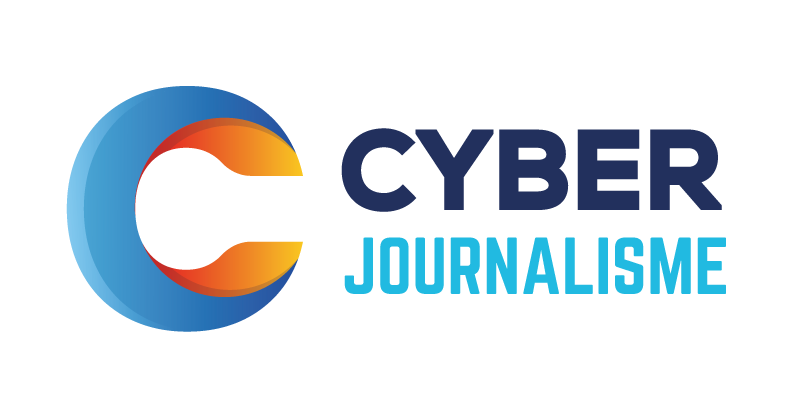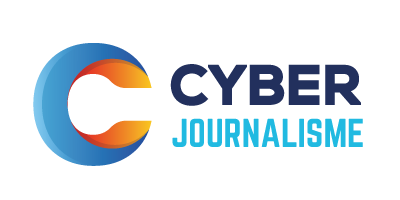Aucun palmarès universel ne fait l’unanimité lorsqu’il s’agit de désigner le plus grand designer. D’un pays à l’autre, d’une décennie à l’autre, les distinctions professionnelles célèbrent aussi bien les pionniers techniques que les inventeurs de silhouettes inoubliables. Tantôt la fonctionnalité est reine, tantôt l’expérimentation ou l’engagement social prennent le dessus.
Les classements se réinventent au gré des écoles, des marchés, des périodes. Une médaille ou une reconnaissance officielle n’équivalent pas toujours à une influence profonde sur la société ou les usages. Les parcours de Philippe Starck et Charlotte Perriand en disent long sur la variété des chemins possibles et sur la mosaïque de critères qui façonnent une renommée dans ce secteur souvent insaisissable.
Le design, reflet d’une époque et révélateur de tendances
Le design puise dans l’histoire de l’art pour mieux s’en affranchir. À chaque époque, il accompagne, devance ou remet en cause les évolutions de la société. Prenez Dieter Rams pour Braun : l’alliance avec l’École de design d’Ulm marque une volonté d’unir la rigueur de la fonction à une esthétique dépouillée, typique de l’Europe d’après-guerre. Paris, New York, Milan : la modernité adopte mille visages, portée par la confrontation des mouvements et des personnalités.
Parmi les alliances majeures, le dialogue entre arts décoratifs et art moderne a trouvé une intensité rare avec Le Corbusier, Charlotte Perriand et Pierre Jeanneret. Ensemble, ils ont imaginé une nouvelle façon d’habiter, avant que Perriand ne poursuive l’aventure créative avec Jean Prouvé et s’investisse dans l’Union des Artistes Modernes (UAM). Ces collaborations ne sont pas de simples signatures croisées : elles transforment la conception de l’objet domestique. Désormais, le designer travaille en équipe, au cœur de réseaux instables et féconds, où les idées circulent librement.
En Italie, tout change avec l’École de Memphis fondée par Ettore Sottsass. Couleurs explosives, formes imprévisibles, rejet des conventions : le design devient manifeste. À Paris, les collections éditées par Cassina ou les expositions du Musée national d’art moderne illustrent la vitalité des échanges entre la France et le reste du monde. Les idées, les objets, les créateurs voyagent, se transforment ; c’est ce mouvement qui fait la richesse d’un écosystème ouvert à la rupture comme à l’emprunt.
Quelques exemples majeurs permettent de saisir la diversité de ces influences :
- Dieter Rams a travaillé pour Braun, qui a collaboré avec l’École de design d’Ulm
- Le Corbusier a collaboré avec Charlotte Perriand et Pierre Jeanneret
- Charlotte Perriand a collaboré avec Jean Prouvé et a été membre de l’Union des Artistes Modernes (UAM)
- L’École de Memphis a été fondée par Ettore Sottsass
Au final, la question du plus grand designer reste mouvante : elle se construit à la jonction de l’art, de l’innovation technique, du marché et de l’engagement. Les matières, les formes, les usages racontent à la fois une époque et la vision unique de celles et ceux qui les créent.
Philippe Starck et Charlotte Perriand : deux visions, un même désir d’innovation
Le parcours de Philippe Starck croise la rigueur inventive de Charlotte Perriand. Deux grandes figures qui illustrent la diversité du design français, chacune défendant une exigence forte : repenser la fonction, bousculer la forme, ouvrir le champ des possibles. Starck, nourri par la pop culture, s’impose à la frontière de l’architecture, de l’objet accessible et des lieux publics. À Paris, il marque de son empreinte le Centre Pompidou aussi bien que des hôtels ou restaurants, oscillant entre provocation et démocratisation. Des objets comme le presse-agrumes Juicy Salif ou la chaise Louis Ghost franchissent le seuil des maisons et des musées, effaçant la barrière entre industrie et art.
En parallèle, Charlotte Perriand incarne une modernité subtile, enracinée dans les échanges avec Le Corbusier, Pierre Jeanneret et Jean Prouvé. Ses meubles, Bibliothèque Nuage, Chaises Les Arcs, Enfilade Cansado, conjuguent sens pratique et générosité des lignes. Marquée par son séjour au Japon dans les années 1940, elle insuffle à ses œuvres une sobriété assumée et une attention nouvelle à la matière. Perriand expose au Musée national d’art moderne, à la Fondation Louis Vuitton, est éditée par Cassina et la galerie Steph Simon, et transmet sa vision à de jeunes designers.
Pour mieux cerner ces deux figures, voici une synthèse de leurs spécificités :
- Philippe Starck : mélange des genres, démocratisation du design, réalisations emblématiques à Paris.
- Charlotte Perriand : héritage moderniste, engagement collectif, influence de l’esthétique japonaise.
Deux démarches, mais une même ambition : replacer l’humain au centre de l’innovation, interroger la fonction sociale du designer et élargir sans cesse l’horizon des possibles.
Qu’est-ce qui fait l’originalité d’une œuvre iconique ?
L’originalité ne s’invente pas, elle s’impose. Une œuvre iconique en design se repère à la justesse de ses lignes, à l’évidence de son usage, à sa capacité à traverser les modes sans jamais s’effacer. Le presse-agrumes Juicy Salif de Starck ou la chaise Louis Ghost en témoignent : des objets qui suscitent l’adhésion, le débat, mais jamais l’indifférence.
Regardez les productions de Dieter Rams pour Braun. Leur rigueur formelle, fruit d’un travail collectif avec Hans Gugelot ou Dietrich Lubs, a influencé jusqu’à Jony Ive chez Apple. La radio T3, la calculatrice ET 55 : sobriété et clarté s’allient à la technologie. La filiation avec les produits Apple saute aux yeux.
La puissance d’une œuvre iconique réside aussi dans sa capacité à dialoguer avec l’histoire de l’art et des arts décoratifs. La chaise longue LC4 de Le Corbusier, éditée par Cassina, ou la chaise Barcelona de Mies van der Rohe deviennent des symboles d’une époque autant que des sources d’inspiration pour les générations suivantes. L’innovation s’appuie sur la mémoire, la transmission n’efface pas la nouveauté.
On retrouve trois caractéristiques essentielles dans ces créations qui traversent le temps :
- Singularité de la forme : aucun détail n’est laissé au hasard.
- Pérennité : l’objet s’inscrit dans la durée, inspire, se renouvelle.
- Écho collectif : le public adopte, détourne, réinvente la création au-delà des intentions du concepteur.
Les œuvres devenues icônes ne se contentent pas d’être agréables à regarder ou pratiques à utiliser. Elles s’ancrent, rassemblent, questionnent et deviennent des références dans l’imaginaire collectif, que ce soit à Paris, Los Angeles ou ailleurs.
Quand le design contemporain s’inspire du passé pour façonner l’avenir
Le design contemporain ne cesse de revisiter le passé pour réinterpréter l’avenir. Les créateurs d’aujourd’hui, de Jean Nouvel à Zaha Hadid, réinvestissent l’héritage du modernisme pour inventer de nouveaux usages, de nouvelles matières. L’École de Memphis, menée par Ettore Sottsass, a bouleversé les codes, imposant la couleur, le choc visuel, la liberté contre la rigueur fonctionnaliste. Ce souffle d’audace résonne dans les œuvres exposées au Musée d’Art Moderne de New York ou dans les collections du Centre Pompidou.
La transmission ne concerne pas que l’objet. Dieter Rams, chez Braun, a formulé dix principes du bon design ; ils irriguent encore la démarche de Jony Ive chez Apple. Simplicité, lisibilité, longévité : autant de valeurs remises en jeu par les géants technologiques. Les produits Apple, salués à Paris, New York ou Tokyo, portent en eux l’ADN des radios et calculatrices conçues autrefois pour Braun.
L’architecture elle-même puise dans le patrimoine du design : la Fondation Cartier de Jean Nouvel, le MAXXI de Rome signé Zaha Hadid, sont des exemples de cette mémoire créative. Les expositions récentes au Musée national d’art moderne ou à la Fondation Louis Vuitton témoignent de ce dialogue permanent entre innovation contemporaine et héritage.
Pour mieux comprendre les dynamiques à l’œuvre, trois axes se dessinent :
- Transmission : chaque génération revisite les acquis de la précédente.
- Hybridation : les frontières entre art, architecture et objet s’effacent pour ouvrir de nouveaux territoires.
- Innovation : la tradition nourrit l’avant-garde, sans jamais l’entraver.
À observer les créations qui peuplent musées, galeries ou nos quotidiens, une chose frappe : le design ne cesse de muter, de s’inspirer, de se dépasser. Qui, demain, incarnera la figure du plus grand designer ? La réponse se construit déjà, dans l’atelier, sur les bancs d’école, ou dans la main de celles et ceux qui réinventent sans relâche nos objets du quotidien.